Personnalités collectives (X)
Floruit (pays actuels) :

⟴Kamo (no Yasunori)🔗 pertinents
Devin 🞄 Onmyōdō 🞄 Japon (Époque de Heian) | 917 – 977
► Pratiquant du 暦術 (rekijutsu) {calendrologie} et du 天文道 (temmondō) {astrologie፧}, inyoka(1) et premier onmyōji. Fils de Kamo no Tadayuki et maître de Abe no Seimei.
◆ Personnage semi-légendaire, on trouve son histoire contée dans le 今昔物語集 (Konjaku monogatari shū) {Anthologie des histoires du passé}.
1.⟴ Importation de l’École du Yin-Yang.
⟴Kalābādhī (Al) Abū Bakr🔗 pertinents


Mystique, Philosophe 🞄 Islam (Soufisme) 🞄 Empire Samanide | ≈ 925 – ≈ 994
► Connu pour avoir rédigé le Kitab at-ta’arruf {Livre de l’information} qui, fondamental pour nous renseigner sur les premiers siècles du soufisme, en présente la doctrine, cite ses maîtres et défend son orthodoxie musulmane. Ce dernier point devenait important à aborder dans la mesure où al-Hallaj est exécuté à Bagdad en 922. Il s’agit d’un des deux traité le plus ancien traitant de soufisme qui fut rédigé en arabe.

⟴Miskawayh🔗 pertinents


Philosophe 🞄 Islam (Chiisme) 🞄 Empire Sassanide | 932 – 1030
► Né à Ray peu de temps avant l’avènement de la Dynastie Bouyide. Influencé par Al-Kindi et Adurbad-i Mahraspand, Miskawayh est un chiite néoplatonicien. Connu pour son تهذيب الأخلاق (Tahdhîb al-Akhlâq) {Le Raffinement du caractère} 
![]() qui traite d’éthique pratique.
qui traite d’éthique pratique.
◆ Ses œuvres furent ℙ compilées dans les Rasâ’il al-Ikhwân al-Safâ’ {Épîtres des Frères en pureté}.

⟴Sylvestre II [Gerbert d'Aurillac]🔗 pertinents

 ❙
❙ 
Ecclésiastique (Pape), Philosophe, Mathématicien 🞄 Christianisme (Chalcédonisme:Bénédictin) 🞄 n. Francie occidentale, fl. États pontificaux | ≈ 948 – 1003
Scholasticus

I. Histoire
► D’origine auvergnate, il est notoirement connu pour être d’origine modeste(1), aussi, aucune documentation ne vient renseigner sa date de naissance. Au début de son adolescence, il est oblat auprès des bénédictins au Monastère de Saint-Gérault à Aurillac où il est ordonné moine bénédictin, étudie la grammaire et l’ars donati sous Raymond de Lavaur de qui il restera proche. Remarqué pour son intelligence et sa prometteuse érudition, il accompagne Borrell II, comte de Barcelone, venu prier sur le tombeau de Géraud d’Aurillac, fondateur du monastère. Ainsi, il est ensuite éduqué à Barcelone puis au Monastère de Santa Maria de Ripoll où, épaulé par l’évêque érudit de Vic, Aton, il lit Boèce, Cassiodore, Martianus Capella et Isidore de Séville, s’initie plus avant dans les artes liberales et plus spécialement le quadrivium. Proche de la frontière avec l’Al-Andalus, il entre alors en contact avec un climat intellectuel qui favorise une formation riche et pour l’époque, hétérodoxe. Ainsi, le jeune moine visite d’abord les abbayes catalanes puis se fait finalement cornaquer par les deux hommes jusque Rome vers 970. Là, il rencontre Jean XIII (reg. 965 – 972) auprès de qui ses connaissances en musique et en astronomie font fort impression, au point d’être retenu afin d’être présenté à Otton Ier (reg. 962 – 973) et devenir le percepteur du jeune Othon II (reg. 967 – 983). À Rome, il tisse un solide réseau de relations, attendu que le lieu était un important carrefour d’idées et de pouvoirs jusqu’à ce que son élève épouse la princesse byzantine macédonienne Théophano Skleraina. Il est ensuite à Reims dès 972 où il est écolâtre à l’école épiscopale durant dix ans et sous la protection de l’archevêque Adalbéron de Reims. Là, il réorganise les études de logique et dialectique, et les élèves de nombreuses régions de l’empire affluèrent pour bénéficier de ces enseignements.
↪ En 980, il est à Ravenne et, en présence de la cour, il confronte l’écolâtre Otric de Saxonie, de l’École épiscopale de Magdebourg, dans une dispute restée célèbre(2). Il devient abbé du Monastère de Saint Colomban à Bobbio (982) grâce à Othon II et ce, malgré les oppositions. Bien qu’il puisse profiter d’un riche scriptorium, l’abbaye est en proie à de graves difficultés économiques et, peu à l’aise sur ces sujets, Sylvestre y est confronté à des troubles administratifs, en plus d’intrigues financières et politiques. Ne parvenant pas à rétablir l’ordre, il revient ensuite à Reims à la mort d’Othon II, auprès d’Adalbéron, et soutient Hugues Capet contre les prétentions de Charles de Basse-Lotharingie, prince carolingien, à accéder au trône des francs. Il est ensuite archevêque de Reims en 991 mais la mince confiance du clergé dans la légalité de son élection le poussa hors de cette charge(3). Conseiller et soutien des ottoniens, il rencontre le jeune empereur Otton III (reg. 996 – 1002) en 996, lui fait parvenir un manuscrit de Boèce et devient son secrétaire et précepteur. L’empereur lui octroie la charge d’archevêque de Ravenne en 998, puis lui fit accéder à la papauté en 999(4) sous le nom de Sylvestre II(5). Durant son pontificat, il s’emploie à amoindrir l’influence de Rome (et conséquemment, de Byzance) dans les affaires de l’Église, notamment des abbayes, tout en augmentant le pouvoir du Pape. Ayant acquis ses responsabilités peu après la période du saeculum obscurum, il conduit également une lutte contre le népotisme, la simonie, l’analphabétisme, et les dérives morales des ecclésiastiques comme le concubinage. Il s’emploie enfin à étendre l’influence de la chrétienté(6). Cependant, privé de sa coopération étroite avec Otton III qui meurt en 1002 et peu suivi politiquement, notamment à cause de ses liens avec l’empereur allemand, il trépasse lui-même en 1003. Son élève, Richer de Reims, rédigera sa biographie. En 1648, lors de la reconstruction de la Basilique Saint-Jean-de-Latran, le corps de Sylvestre II fut retrouvé intact avec tous ces attributs pontificaux, mais, exposé à l’air libre, le corps embaumé s’y dispersa promptement.

Œuvre
Nom : Le Pape Sylvestre II avec le Diable
Auteur : Culture allemande
Date : ≈ 1460
Type : Enluminure
Source : in Chronicon pontificum et imperatorum (Cod. Pal. germ. 137) bs. Bibliothèque universitaire de Heidelberg 
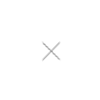
II. Pensée et réputation
◆ Sylvestre est certainement l’un des plus grands érudits et pédagogue du moyen-âge, anticipant la figure de l’humaniste. Il endosse déjà cette réputation de son vivant dans tous les pays de la chrétienté et ce savoir dont il est détenteur trouve son fondement dans son approche de l’héritage antique et de la scientia arabum. Amoureux des arts et des sciences, détenteur d’un savoir polyvalent et collectionneur passionné de manuscrits, il est spécialement reconnu pour sa connaissance approfondie de la langue arabe puis des mathématiques, de l’arithmétique et de la géométrie ainsi que des disciplines connexes dans lesquelles il excelle : astronomie, musique et mécanique. Influencé par Érigène, usant de la rhétorique et de la dialectique, il est l’auteur d’importants ouvrages théologiques et philosophiques(7) où il fait montre d’une sympathie pour les idées platoniciennes et s’applique à harmoniser culture antique et chrétienne. Il plaide notamment pour une réception des connaissances antiques et arabes afin de nourrir la culture occidentale. Afin de soutenir cette idée, artisan important de la renaissance intellectuelle du X, il vulgarise et valorise ces connaissances dans les écoles des monastères. Notamment, il réintroduit l’étude d’œuvres qui n’étaient alors que généralement peu admises dans les monastères : Virgile et Horace, Sénèque et Quintilien ainsi que les Topica de Cicéron pour la rhétorique. Il fait encore étudier l’Isagoge de Porphyre, les Catégories et le De l’Interprétation d’Aristote ainsi que le corpus de Boèce pour la dialectique. Il encourage également la terminologie ainsi que les traductions arabes. Aussi, par cette influence, il donnera une audience élargie aux travaux d’Hermann Contract, Fulbert de Chartres(8) ou encore Walcher de Malvern. Il semble également qu’en arithmétique, il donna une visibilité théories phythagoriciennes dans l’esprit de Nicomaque de Gérase. Son œuvre illustre en fait, la profondeur des transferts culturels entre l’Europe chrétienne et l’Europe musulmane.
↪ Sylvestre introduit notablement l’utilisation des astrolabes dans la civilisation chrétienne, outil facilitant notamment la réalisation d’horoscopes, et dont l’usage deviendra alors la norme dès le XI. Lui-même a été mis en contact avec un astrolabe au monastère de Reims en 989. Dans son ouvrage consacré à l’astrolabe, il renforce la distinction opérée par Isidore de Séville entre l’astrologie naturelle et l’astrologie superstitieuse. On lui attribue encore — sans doute à tord historiquement parlant — l’introduction du système de numération indo-arabe au détriment des chiffres romains, le perfectionnement de l’usage de l’abaque et des sphères armillaires pour les cours d’astronomie, ainsi que l’invention de plusieurs inventions inédites pour l’époques comme l’horloge à balancier ou l’orgue à vapeur. Ces centres d’intérêts, inédits pour l’époque, et sa connaissance des artes mechanicae ainsi que son ascension sociale inhabituelle, contribuèrent à persuader des auteurs, dès le XI-XII, qu’il fut magiste, sage transgressif dans le continuum d’un Salomon et d’un Albert, et même qu’il contracta un pacte avec le Diable(9). Dès lors, on lui attribua, de façon persistante jusqu’au XX(10), les motifs classiques des antiques et des latins associés au sorcier : conversations avec le Diable, invention d’une tête de cuivre oraculaire(11), possession d’un livre de nécromancie, lui permettant de soumettre les démons et découvrir les trésors(12) et détention d’une immortalité déceptive(13). On ajouta aussi l’idée que son tombeau suintait et émettait des craquements lorsque le décès d’un Pape était proche.
☩ 𝕍 1. A Pope-Philosopher of the tenth century: Sylvester II in The Catholic historical review (V°8, N°1 pp. 42-54), William Kitchin, 1922. | 2. Otton III et Sylvestre II, l’empereur et le pape de l’an mil. Leur rêve de renouveau dans l’unité in Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (A°143, N°4 pp. 1215-1223), Francis Rapp, 1999. ![]() | 3. Gerbert d’Aurillac et Jules Verne au milieu du XIXe siècle in Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France (A°2015, pp. 85-96), Pierre Riché, 2015.
| 3. Gerbert d’Aurillac et Jules Verne au milieu du XIXe siècle in Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France (A°2015, pp. 85-96), Pierre Riché, 2015. ![]()
1.⟴ La tradition rapporte qu’il gardait les troupeaux durant son enfance.
2.⟴ Il s’agit sans doute du débat philosophique le plus important du X concernant le rôle de la philosophie vis à vis de la foi.
3.⟴ Durant cette période, il doit se défendre contre les attaques de la cour pontificale. Sur fond de controverses et d’intrigues politiques impliquant capétiens, carolingiens et papauté, il était en effet en concurrence avec Arnoul de France pour détenir le siège laissé vacant suite à la mort d’Adalbéron en 987, qui avait choisit Sylvestre comme son successeur. Reims en effet, était à cette époque le siège métropolitain le plus important du royaume, et la charge d’archevêque de Reims au premier plan politique et ecclésiastique. Il prendra la place d’Arnoul en 991, Sylvestre devra d’ailleurs rédiger les actes du Concile royal à l’abbaye de Saint-Basle, convoqué par le roi Hugues Capet et ayant déposé son rival. Mais Arnoul devra la reprendre en 997 après l’intervention de Rome et de Grégoire V, qui fulmina contre une telle décision. Refusant d’abandonner sa charge, Sylvestre est alors suspendu et excommunié par le Pape.
4.⟴ Il est le premier pape français, succédant d’ailleurs à Grégoire V (reg. 972 – 999), premier pape allemand.
5.⟴ Par l’association du pouvoir impérial et pontifical, les deux hommes caressaient le projet impérial de la renovatio imperii en promouvant la restauration de l’empire de Charlemagne et même, la grandeur d’un Empire romain chrétien renouvelé, centrant cette restauration sur Rome. Cependant, le conflit entre romains et tivoliens provoque une insurrection qui oblige les deux hommes à quitter Rome en 1001. Du reste, Othon III devra périr seulement trois ans après l’élection de Sylvestre, laissant le projet inachevé.
6.⟴ Il soutient notamment l’évangélisation de la Pologne et de la Hongrie en établissant des métropolites ecclésiastiques, envoie des diplomates à Kiev et en Dalmatie, exige l’abandon de l’usage de l’écriture runique auprès de Olaf Tryggvason (reg. 995 – 1000) ou sera encore l’un des premiers à lancer à la chrétienté un appel à la croisade contre les turcs, qui venaient de s’emparer de Jérusalem.
7.⟴ Notamment le De rationali et de ratione uti.
8.⟴ On a prétendu que le célèbre fondateur de l’École de la cathédrale de Chartres fut son élève à Reims, mais le fait est discuté.
9.⟴ Cette calomnie semble devoir remonter au Gesta Romanae Ecclesiae contra Hildebrandum du cardinal Beno, hostile au pontificat de Grégoire VII au profit de l’antipape Clément III. Le Démon lui assura qu’il ne mourrait qu’après avoir lu la messe à Jérusalem, aussi le Pape évitait-il cette ville. Mais, étant à la Basilique Sainte-Croix-de-Jérusalem de Rome (lieux où il mourut effectivement), il se sentit défaillir et périt dans le remord.
10.⟴ Welf, Castellan d’Osbor d’Hugo est le meilleur exemple de ces échos lointains.
11.⟴ Peut-être encouragé par sa fabrication de l’éolipyle.
12.⟴ On lui associe, à cet égard, les motifs du conte Percute hic de la Gesta Romanorum et une capacité à voyager dans les souterrains de la Rome antique pour s’emparer des trésors d’Octave.
13.⟴ Le Démon lui assura qu’il ne mourrait qu’après avoir lu la messe à Jérusalem, aussi le Pape évitait-il cette ville. Mais, étant à la Basilique Sainte-Croix-de-Jérusalem de Rome (lieu où il mourut effectivement), il se sentit défaillir et périt dans le remord.
Abhinavagupta🔗 pertinents


Mystique, Philosophe, Poète 🞄 Hindouisme (Shivaïsme), Tantrisme 🞄 Dynastie Utpala | ≈ 950 – ≈ 1016
► Peu d’informations biographiques sont disponible si ce n’est celles qu’il livre lui-même. Brahmane shivaïte du Cachemire et ascète, intéressé par l’art et l’esthétique (rasāsvadā) qu’il rapproche de l’extase mystique, il est un représentant très important de l’école moniste pratyabhijña de Somānanda. Perdant sa mère alors qu’il est encore jeune, cet évènement précipite son intérêt pour la spiritualité; il est éduqué par son père, qui, fidèle de Shiva, lui enseigne la logique, la littérature et la grammaire. Il suit ensuite l’enseignement de plusieurs maîtres: shivaïstes bien sûr, mais aussi vishnouïtes et bouddhistes, cependant, Śambhunātha est celui qu’il révère le plus. Particulièrement intéressé par le Mālinīvijayottara Tantra(1), attaché à la théorie du रस (rasā) {saveur (essentielle)} de Bharata et à la notion de स्पन्द (spanda) {vibration (cosmique)} de Vasugupta, sa notion de l’absolu intègre la dualité et l’unité.
↳ Il écrit ainsi : Cet Un dont l’essence est l’immuable Lumière de toutes les clartés et de toutes les ténèbres, en qui clartés et ténèbres résident, c’est le Souverain même, nature innée de tous les êtres; la multitude des choses n’est rien d’autre que son énergie souveraine. / Et l’énergie ne se pose pas comme séparée de l’essence de celui qui la possède. Il y a éternellement identité des deux comme du feu et de son pouvoir de brûler. / Lui, le Dieu Bhairava, a pour caractéristique de maintenir l ’univers tout entier reflété, grâce à cette énergie, dans le miroir de son propre Soi. / Elle, la suprême Déesse, s’adonne à la prise de conscience de l’essence de celui même dont la plénitude en tout ce qui existe n’augmente ni ne diminue. / Ce Dieu s’adonne éternellement au plaisir de jouer avec cette Déesse ; omniscient, il suscite de façon simultanée les diverses émissions et résorptions. / Telle est son incomparable activité, éminemment difficile à accomplir ; telles, sa liberté sa souveraineté, son Essence consciente de soi. / Certes une lumière consciente limitée caractérise l’inconscience; par contre la Conscience n’a pas pour caractéristique l’inconscience parce qu’elle n’a pas de limite / Ainsi les émissions et résorptions se manifestent à cause de leur propre essences à l’intérieur du Soi, elles dont la différenciation dépend des énergies spécifiques de Celui qui est (essentiellement) libre. / Leur extrême diversité, ces mondes en haut, en bas, intermédiaires et ce qui les constitue, voilà l’existence douée de plaisir et de douleur. / L’imparfaite connaissance de ce (Bhairava), c’est elle que l’on considère comme Sa liberté, elle, en vérité, la transmigration, terreur des êtres bornés / Inclination de Sa grâce, tradition du maître ou traités religieux, que par l’une ou l’autre de ces approches s’éveille la Connaissance parfaite de la Réalité - le Seigneur suprême - voilà la délivrance, la plus haute souveraineté, la plénitude des êtres illuminés, voilà encore ce que l’on nomme libération en cette vie. / En réalité aucune différenciation n’existant en Parameśvara, ces deux, lien et libération, ne sont nullement séparés de l’Essence du Seigneur suprême. / Ainsi entre-t-on en contact de façon répétée avec Bhairava, nature innée de toute chose, qui repose sur le lotus du trident formé par les énergies : connaissance, activité subtile et volonté.
(Quinze stances sur la conscience in Hymnes de Abhinavagupta, Lilian Silburn, 1970)
► Il est principalement l’auteur de l’encyclopédique Tantrāloka {L’Élucidation du tantra} synthétisant les enseignements du Trika influencé par la kaulācāra et qui constitue l’un des traités les plus importants du tantrisme(2). Dans le domaine philosophique, il commente l’Īśvarapratyabhijñā {Stances sur la reconnaissance du Seigneur} d’Utpaladeva avec son traité sobrement intitulé Īśvarapratyabhijñā-vimarśini {Commentaires des Stances sur la reconnaissance du Seigneur}. Il est aussi l’auteur d’un commentaire(3) du Nāṭyaśāstra de Bharata, l’Abhinavabhāratī.
➽ Son influence dans le shivaïsme est si importante qu’il est parfois considéré comme un avatar de Shiva. Maître de Kṣemarāja.
1.⟴ Texte fondamental du Trika.
2.⟴ En fra. 𝕍 cette trad. partielle : La Lumière sur les tantras, Lilian Silburn, 1998.
3.⟴ Le plus ancien dont nous disposions.

⟴Nāropā🔗 pertinents

Moine, Érudit, Mystique 🞄 Bouddhisme (Vajrayāna) 🞄 n. ℙ Empire Samanide, fl. Dynastie Thakuri | ≈ 950 – ≈ 1040
L’Intrépide | Mahāsiddha
I. Histoire
► Il existe plusieurs sources plus ou moins merveilleuses sur la vie de Nāropā, toutes basées sur des hagiographies tardives. Il est soit fils d’un shunri bengali ou même d’un souverain, soit le fils d’un brahmane du Cachemire, ? à Lahore ou Srinagar. Né Samantabhadra, il souhaite rapidement devenir moine et il étudie le bouddhisme dès ses onze ans. Mais, à dix-sept ans, il se voit contraint de prendre épouse. Le mariage dure huit ans, après quoi Nāropā se sépare de sa femme(1) et se rend au à l’Université bouddhiste de Nālanda (ajd. Rajgir, Bihar) et se fait ordonner. À force d’étude, il devient réputé pour son érudition et son éloquence lors des débats philosophiques(2), aussi il devient abbé et enseignant. Il reçoit le nom de "Abhayakīrti" et obtient la fonction importante de "gardien de la porte nord". Un jour cependant, alors qu’il étudie un texte tantrique dans la bibliothèque, il reçoit la visite d’une vielle et affreuse femme hagarde en train de danser — une dakini émanant de Vajrayogini — qui l’interroge sur sa faculté à comprendre ce qu’il lisait : les mots ou le sens ? Lorsque Nāropā affirma qu’il comprenait les deux, la femme cessa de danser et pleura. Elle l’accusa que, malgré tout son savoir, il était aussi un menteur et lui indiqua que son frère Tilopa, lui, connaissait la véritable signification des mots. Entendant le nom de Tilopa, il ressentit instantanément une puissante dévotion. Aussi et malgré la déception de ses confrères, convaincu qu’il ne connaissait que la superficielle écorce des enseignements, il abandonna ses études et son statut et s’en fut à la recherche de son maître.
↪ Lors de son voyage, il fit douze rencontres, douze épreuves mineures, manifestations de Tilopa : une lépreuse, une chienne dévorée par les vers, un manipulateur, deux hommes découpant un cadavre, un homme ébouillantant l’estomac d’un homme encore vivant, un roi qui le retient prisonnier et lui fait épouser sa fille, un chasseur de daim, un vieux pêcheur faisant frire des poissons vivants, un criminel assassinant ses parents, un mendiant lui demandant de tuer ses poux. Ne pouvant reconnaître son maître, il finit par arriver dans un lieu où plus rien n’avait de sens et, désespéré, il voulut se suicider. Mais Tilopa intervint et lui dit dans son esprit : Toi qui n’as pas trouvé le gourou, comment peux-tu espérer le rencontrer si tu tues le bouddha en toi ? Ne suis-je pas celui que tu cherches ?
et Nāropā dès lors, reconnu son maître.
↪ Il se rendit dans le village du maître, mais Tilopa était vêtu comme un simple pêcheur. Nāropā le pressa pour devenir son disciple, mais Tilopa répondit que son véritable disciple sauterait de la falaise. Nāropā s’exécute et se brise les os, mais Tilopa le guérit d’un simple touché et accepte alors de devenir son enseignant. Le maître donna alors à Nāropā les quatre lignées de transmission grâce à douze symboles afin qu’il puisse pratiquer et lui fit ensuite traverser douze terribles épreuves majeures afin de purifier son karma. Sa formation durera douze ans. Ayant reçu l’intégralité de la transmission du mahāmudrā et parvenu à l’éveil complet(3), il fit une retraite à Phullahari(4), cependant, Tilopa lui intima de réintégrer le monde. Nāropā épouse alors la princesse Jnanadipi, mais parce qu’ils s’étaient comportés de façon scandaleuse, le roi ordonna qu’on les fit brûlés vifs. Pourtant, une semaine plus tard, on les retrouva lumineux et dansants dans les flammes et le roi reconnu son erreur. Bien des aventures plus tard, Nāropā s’installa au monastère de Siromani où il rencontra Marpa, son principal disciple(5).
II. Pensée et œuvres
◆ Nāropā est, avec Tilopa, le mahāsiddha indien le plus connu et il est très vénéré au Tibet pour ses enseignements tantriques. Il est spécialement reconnu pour sa confiance envers Tilopa, attitude qui lui permit d’atteindre l’illumination en une seule vie. C’est un important représentant du mahāmudrā. On trouve plusieurs ouvrages de chants spirituels et de commentaires tantriques qui, conservés dans le Kangyour lui sont attribués. Il est notamment considéré comme l’auteur de la Sekoddeśaṭīkā, commentaire du དབང་མདོར་བསྟན་པ། (Sekoddeśa), premier texte tantrique du Kangyour faisant parti du tantra de kalachakra. Mais surtout, sous son nom, ses méthodes d’exercices méditatifs sont introduites au Tibet par son disciple Marpa au XI : ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག (na-ro’i-chos-drug) {six doctrines de Nāropā}. Ces techniques, fondamentales pour la Kagyupa font de Nāropā leur précurseur : il est le troisième membre de la lignée du Rosaire d’Or. La liste des exercices telle que définie par Gampopa est constituée de six techniques correspondant en partie à celles du Bardo Thödol. Elles font parti du stade d’achèvement de l’anuttarayoga tantra. Leur maîtrise, mène au contrôle des énergies du corps subtil, principalement constitué des ཐིག་ལེ། (tiglé) {essences}, des རྩ (tsa) {canaux} et des རླུང (lung) {souffles} qui circulent à l’intérieur. Ce contrôle peut mener au développement des siddhis par le truchement de l’intégration du corps dans le processus psychique mais surtout, à l’illumination en unissant la vacuité et la conscience.
↳ Ces six techniques sont : 1. གཏུམ་མོ་ (tummo), chaleur mystique interne, 2. སྒྱུ་ལུས, (gyulü), corps physique illusoire, 3. རྨི་ལམ་, (milam), état de rêve, 4. འོད་གསལ་, (ösel), claire lumière radiante, 5. བར་དོ, (bardo) théorie de l’état intermédiaire, 6. འཕོ་བ་, (phowa) transmission de la conscience. Tilopa affirmait que chaque technique provenait d’un maître différent : à Charyapa tummo, à Nāgārjuna gyulü et ösel, à Lavapa milam, à Pukasiddhi bardo et phowa. Milarépa résume : La chaleur interne embrase tout le corps — Volupté ! / Les courants d’énergie se rassemblent dans les trois canaux — Volupté ! / Le fleuve de l’esprit d’illumination inonde tout d’en haut — Volupté ! / Le potentiel d’énergie, rayonnant, se remplit tout en bas — Volupté ! / Le masculin et le féminin s’harmonisent au milieu — Volupté ! / Le corps est rempli d’une félicité sans ombre — Volupté !
.
1.⟴ On considère parfois qu’elle devient sa disciple sous le nom de Niguma; unes deux fondatrices, avec Sukhasiddhi, de la lignée mineure Shangpa Kagyü. Occasionnellement, elle est simplement sa sœur.
2.⟴ Gagner un débat signifiait à ce moment là, gagner également un disciple, ce qui pouvait d’ailleurs conduire à convertir des hindous au bouddhisme.
3.⟴ Cela se serait passé dans deux grottes sur le site du Temple de Pashupatinath, au Népal.
4.⟴ Dans d’autres versions il enseigne là-bas une trentaine d’années jusque sa mort.
5.⟴ Le fait qu’il soit le maître direct de Marpa est sujet à caution. D’ailleurs, on en fait aussi quelquefois le maître d’Atisha, Maitrīpāda ou encore Kukkuripa.

⟴Abenragel Haly [Shaybani (al) Ali]🔗 pertinents


Astrologue, Philosophe, Poète 🞄 Islam (Sunnisme) 🞄 n. Califat de Cordoue, fl. Émirat Ziride | ≈ 965 – ≈ 1040

Œuvre
Nom : Abenragel entrôné entre l’astronomie et l’astrologie
Auteur : Impr. Giovanni Battista Sessa
Date : 1503
Type : Gravure sur papier
Source : in Preclarissimus in Judiciis Astrorum (in Bibliotheca Electoralis Sign. 2 Math.VII,3 
 )Bibliothèque universitaire et du land de Thuringe
)Bibliothèque universitaire et du land de Thuringe 
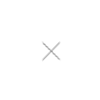
► Autorité astrologique considérable, dit Ptolemeus alter, summus astrologus et notablement connu aussi comme "Albohazen". Né à Cordoue, on sait qu’il est à Bagdad en 988 (est-il formé là-bas ?). Astrologue, précepteur et chancelier du troisième émir ziride Al-Muizz ben Badis (reg. 1016 – 1062) à partir de 1016, il est ainsi actif en Ifriqiya. Auteur d’un Kitāb al-bāri’ fī aḥkām an-nujūm (≈ 1030-1060), qui, compilation encyclopédique, faisant un usage inédit d’aphorismes, et s’appuyant sur des autorités antérieures tels Hermès, Dorothée, Valens, Ptolémée, Masha’allah ou al-Kindî(1), connaîtra une immense renommée.
◆ Composé de 8 livres ils sont organisés comme suit : I-III abordent les généralités, IV-VI détaillent les nativités avec les transits, VII est dévolu aux élections, le dernier est dédié aux jugements annuels i.e. l’astrologie mondiale. Sur ordre d’Alphonse X de Castille, il sera traduit par Yehudā ben Moshe en vieux castillan (Libro complido de los judizios de las estrellas) en 1254. Il sera ensuite diffusé en lat. dans la traduction d’Aegidius de Tebaldis dès 1256 puis imprimé toujours en lat.(2) où là aussi, il devient très influent et constitue une source majeure pour la connaissance de l’astrologie፧ arabo-latine : d’abord 1485 
 , 1503 et 1523, 1525 à Venise puis dans un lat. plus élégant en 1551
, 1503 et 1523, 1525 à Venise puis dans un lat. plus élégant en 1551 
 et 1571 à Bâle. Il existe cependant une version en fra. (Du Jugement des estoilles) dès 1430 par Guillaume Harnois (notez plusieurs mss. à la BNF).
et 1571 à Bâle. Il existe cependant une version en fra. (Du Jugement des estoilles) dès 1430 par Guillaume Harnois (notez plusieurs mss. à la BNF).
1.⟴ Mais beaucoup ne sont plus identifiables.
2.⟴ D’abord Praeclarissimus liber completes in judiciis astrorum puis simplement De Judiciis seu fatis stellarum.

⟴Abī al-H̲ayr (ibn) Abū Saʿīd🔗 pertinents

Poète 🞄 Islam (Soufisme) 🞄 n. Oghouze-Yabgou, fl. Empire Samanide | 967 – 1049
► Bien que né au Turkménistan, il a passé la majeure partie de sa vie à Nishapur. Son père, médecin et herboriste était intéressé par le soufisme et enfant déjà, Abū Saʿīd est mis en contact avec cette communauté qu’il finit par rejoindre à 23 ans après des études de théologie et de littérature. Influencé par Hallaj — qu’il révère — et Bastami, délaissant la philosophie, il s’exprime par la poésie(1) et est caractéristique de l’école mystique du Khorasan. Son attitude extatique, excentrique et indifférente lui valut également les critiques des autorités religieuses comme de certains soufis attachés au légalisme(2). اسرار التوحید فی (Asrār al-tawḥīd) {Les Mystères de l’unicité}, composé par son petit-fils, chef d’œuvre de la prose perse et œuvre fondatrice pour la littérature mystique soufie, contiennent l’essentiel de ce qui est connu de sa biographie historique et hagiographique ainsi que ses dits, poèmes et correspondances (ntm. avec Avicenne).
☩ 𝕍 La Direction spirituelle chez Abū Sa‘īd b. Abī l-Ḫayr in Les maîtres soufis et leurs disciples des IIIe-Ve siècles de l’hégire, Paul Ballanfat, 2012 ![]() .
.
1.⟴ Il s’avère fondamental pour la constitution de la poésie soufie, ntm. par l’emploi de champ lexical de l’amour pour décrire l’union mystique.
2.⟴ Attitude qui évoque celle des ملامتية (Malāmatiyya) {Gens du blâme}.

Fiches individuelles (X)
Avicenne (980 – 1037)
Version: 1.5
Maj : 23/05/2025






